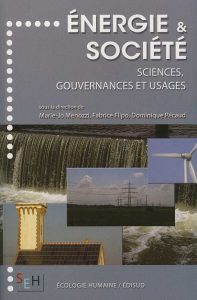Sommaire
MENOZZI Marie-Jo, FLIPO Fabrice, PÉCAUD Dominique
Introduction
LE BRIGRAND Michel
Point de vue
Part 1 Introduction
CHEN Cécilia
L’électricité, l’éclairage et les rythmes urbains
CANTALAUBE Jean
Le charbon de bois et la forge à la catalane (Pyrénées, XVIIe et XIXe siècles)
BRITO Gustavo
PROALCOOL : Analyse sociohistorique de l’initiative brésilienne de production d’éthanol
PÉCAUD Dominique
L’énergie au travail, une métaphore moderne de l’homme au travail
ROUÉ Marie
Discours sur l’énergie hydroélectrique
TOPÇU Sezin
L’énergie nucléaire et la politique des mots
FOUILLÉ Laurent
Entropie et anthropologie : dépendance automobile et fin du pétrole
CARON Florian
Volonté de maîtrise et guitare électrique
COCHET Yves
L’exubérance énergétique d’Homo sapiens
FLIPO Fabrice
Rendre à la nature ? Une lecture bataillienne de la crise énergétique
LEMAIRE Xavier
De quelques mythes et réalités de l’énergie solaire photovoltaïque en milieu rural africain
SOUCHON-FOLL Laetitia, TAROZZI Sylvie
Éléments pour une évaluation socio-énergétique des TIC
ÉVRARD Aurélien
Les choix énergétiques au prisme de la science politique
ZELEM Marie-Christine
Des lampes basse consommation en panne de diffusion
BESLAY Christophe
Individualisation des frais de chauffage et maîtrise de la demande en énergie
Sommaire
MENOZZI Marie-Jo, FLIPO Fabrice, PÉCAUD Dominique
Introduction
LE BRIGRAND Michel
Point de vue
Part 1 Introduction
CHEN Cécilia
L’électricité, l’éclairage et les rythmes urbains
CANTALAUBE Jean
Le charbon de bois et la forge à la catalane (Pyrénées, XVIIe et XIXe siècles)
BRITO Gustavo
PROALCOOL : Analyse sociohistorique de l’initiative brésilienne de production d’éthanol
PÉCAUD Dominique
L’énergie au travail, une métaphore moderne de l’homme au travail
ROUÉ Marie
Discours sur l’énergie hydroélectrique
TOPÇU Sezin
L’énergie nucléaire et la politique des mots
FOUILLÉ Laurent
Entropie et anthropologie : dépendance automobile et fin du pétrole
CARON Florian
Volonté de maîtrise et guitare électrique
COCHET Yves
L’exubérance énergétique d’Homo sapiens
FLIPO Fabrice
Rendre à la nature ? Une lecture bataillienne de la crise énergétique
LEMAIRE Xavier
De quelques mythes et réalités de l’énergie solaire photovoltaïque en milieu rural africain
SOUCHON-FOLL Laetitia, TAROZZI Sylvie
Éléments pour une évaluation socio-énergétique des TIC
ÉVRARD Aurélien
Les choix énergétiques au prisme de la science politique
ZELEM Marie-Christine
Des lampes basse consommation en panne de diffusion
BESLAY Christophe
Individualisation des frais de chauffage et maîtrise de la demande en énergie
Introduction
par Menozzi M.-J., Flipo F., Pécaud D.
La question de l’énergie, au sens de sa disponibilité, sa raréfaction éventuelle et sa consommation semble installée pour longtemps sur le devant de la scène. Le renouvellement de l’énergie, les modalités de sa production et de sa consommation soulèvent de multiples interrogations qui rejoignent des préoccupations plus générales ayant trait au phénomène du réchauffement climatique, à la disponibilité en ressources fossiles et à l’orientation de l’activité humaine vers un développement durable. Notre manière de vivre dans les sociétés occidentales, organisée autour de l’abondance énergétique issue de l’exploitation des ressources fossiles est remise en cause. Depuis les révolutions industrielles du dix-neuvième siècle, et de manière accrue depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le mode de vie des sociétés occidentales impose une consommation énergétique importante. Cette « dépendance » énergétique n’est pas sans effet sur l’organisation sociale, mais, réciproquement, celle-ci influence les formes de production et de consommation énergétiques. Par exemple, certaines de ces modalités d’organisation seraient probablement différentes si le courant continu à basse tension avait été préféré au courant alternatif de haute tension. En effet, ce dernier, non stockable, favorise une production centralisée et l’existence d’un réseau unifié pour faciliter sa diffusion, alors que le courant continu à basse tension, stockable s’accommode mieux d’une production délocalisée dans de petites unités spécialisées. Le choix technique en faveur du courant alternatif fut aussi un choix d’organisation sociale (Gras et Poirot-Delpech, 1993). Nous pouvons également remarquer qu’à un niveau microsocial, la gestion et l’utilisation de l’électricité structure et est structurée par l’organisation de la cellule familiale (Desjeux et al., 1996), ou bien encore que l’organisation de l’espace social, la distance entre nos lieux de vie et de travail sont pour partie conditionnées par la disponibilité d’une énergie peu onéreuse. Les sciences humaines et sociales ne se préoccupent guère de l’objet « énergie » comme d’un élément constitutif de faits sociaux. Wilhite (2001 ; 2005) n’hésite pourtant pas à affirmer que l’énergie a besoin de l’anthropologie alors que, le plus souvent, les débats sur l’énergie restent cantonnés à des préoccupations « techniques » ou économiques. De plus, malgré la répétition des déclarations des responsables politiques à ce sujet, les politiques publiques incitant à la maîtrise de l’énergie restent rares, et la consommation nette par habitant stable ou en augmentation.
Les aspects disciplinaires La définition actuelle de l’énergie est l’héritage du développement de la société industrielle au XIXe siècle, plus précisément d’une société « thermo-industrielle » (Gras, 2002) s’appuyant, grâce à la maîtrise « du feu » sur l’usage d’une énergie produite par la vapeur issue de la combustion d’énergies fossiles comme le charbon, puis, plus tard, le pétrole, le gaz ou l’uranium. L’usage de ces énergies est concomitant de l’émergence de modes de vie, de production et de consommation organisés à partir de méga-machines qui modifient en même temps nos représentations de l’espace, du temps. C’est donc, de manière plus générale la relation homme-nature qui se trouve ainsi bouleversée. Jusque là, l’énergie utilisée provenait le plus souvent de sources renouvelables, telles la biomasse animale, l’énergie humaine, le vent ou l’eau. L’utilisation de l’énergie fossile entraîne une nouvelle manière de « gérer » l’énergie, en la distribuant et en la stockant pour différer son usage. L’énergie devient, non plus une chose à réguler la plupart du temps de manière collective, mais plus une chose qu’il s’agit d’emprisonner, de s’approprier en grandes quantités pour ensuite la redistribuer. Elle alimente un imaginaire nouveau portant sur la légitimité d’une prédation généralisée de la nature. De plus, la consommation énergétique constitue une manifestation du « progrès ». Par exemple, Gras et al. (1993) affirment que le projet d’exploiter des stocks de charbon ne pouvait provenir de sociétés fondées sur un rapport avec la nature d’équilibre et de prise en compte de renouvellement des ressources. L’énergie telle qu’elle est pensée par la société et la science occidentale du XIXe siècle n’induit pourtant pas que les sociétés non occidentales ou les sociétés historiquement antérieures ne se représentaient pas l’énergie. Toutes concevaient le monde comme un échange incessant de transformations. L’énergie comme ressource et comme usage reste le plus souvent présentée comme une condition technique de l’organisation des groupements humains et non pas comme l’un des éléments de cette organisation et de sa stabilité. Depuis l’avènement de la thermodynamique, s’est imposée l’image d’une énergie comprise comme une réalité purement physique pouvant être maîtrisée grâce à des procédés techniques teintés d’une rationalité réputée « naturelle » et universelle : le calcul économique.
L’énergie devient alors un facteur de production parmi d’autres, et pas le plus important, puisque son coût, dans la comptabilité des entreprises et des nations, est allé en diminuant au fur et à mesure du développement industriel. Seules quelques « crises énergétiques » secouent épisodiquement cette vision des choses, mais, le marché étant réputé révéler la valeur que les acteurs attribuent aux choses, l’énergie, jusqu’à des temps récents, a progressivement perdu sa valeur au fur et à mesure que son prix baissait.
Le primat de la lecture économique des sociétés humaines a conduit à une tendance à dépeindre un développement universel caractérisé par une succession de « phases » déclenchées les unes après les autres par des événements particuliers. Les sociétés auraient donc connu une vie agricole pendant des millénaires, puis elles auraient découvert une rationalité particulière leur permettant de développer leur industrie, puis elles se seraient tertiarisées, le secteur économique dit « primaire », dont fait partie le secteur de « l’énergie », étant peu à peu réduit à la portion congrue. Enfin, les machines grossières vont faire un usage de plus en plus fin et précis de l’énergie (Simondon, 2001), ce mouvement culminant dans les technologies de l’information et de la communication. Cette vision économique des sociétés humaines a joué un rôle prépondérant, reléguant le plus souvent d’autres approches anthropologiques et ethnologiques, à la marge de la réflexion. De plus, celles-là se sont souvent appuyées sur cette vision dominante, la tenant pour un résultat acquis de la recherche. Debeir et al. (1986) constatent qu’une telle approche conduit à l’étude de plus en plus spécialisée des procédés techniques et du rapport machines – capitaux, de l’organisation du travail mais aussi des réseaux d’échange comme éléments dominants de la réflexion sur l’énergie.
Cette tendance est visible dans les pays occidentaux aussi bien que dans les pays dits en développement. Baudy et al. (1995) soulignent le manque de prise en compte des facteurs sociaux et culturels dans l’élaboration de stratégies ou de politiques énergétiques. Pourtant l’énergie reste un fait social. Les conditions techniques de sa production et de son utilisation sont étroitement enchâssées dans l’organisation de toute action collective, à la fois à travers les pratiques et les systèmes de représentations. La réflexion sur l’énergie fossile et sur son usage dans la société industrielle peut développer un regard critique à propos du rapport que nous entretenons avec la nature, à propos des rapports sociaux agressifs ou déséquilibrés que cet usage impose, à propos d’une légitimation implicite d’une dégradation de la nature qu’il induit. La manière dominante d’envisager la question de l’énergie illustre le cloisonnement des approches disciplinaires, à partir d’une opposition définie a priori entre « nature » compris comme ce qui constitue l’universalité des déterminations matérielles et « culture », qui renvoie à la diversité des manifestations individuelles et collectives et à leur dimension subjective et institutionnelle. Aux ingénieurs et aux économistes revient l’étude de ce qui relève de la nature et de la maîtrise des éléments matériels, organisés autour de réseaux appréhendés à travers leur dimension technique. Pendant ce temps, on peut observer du côté des sciences sociales une propension à évacuer les questions relevant des techniques et la dimension matérielle de l’analyse des mondes sociaux. Ainsi la question énergétique est-elle finalement renvoyée à un ordre naturel. L’énergie reste donc « la chose » des économistes et des ingénieurs, les sciences humaines ne s’y intéressant qu’épisodiquement, et le plus souvent pour s’en émerveiller – le triomphe de l’homme sur la nature – ou s’en affliger – la soumission des êtres humains à une méga-machine dont la logique deviendrait de plus en plus étrangère à l’exercice de leur subjectivité.
Naturalisation d’une circulation particulière de l’énergie Pour cet ouvrage, nous avons souhaité mettre au même rang des éléments qui composent les sociétés et leur histoire, l’énergie et ses usages. Nous pensons que l’énergie constitue à part entière la forme des sociétés alors que les points de vue dominants l’entraînent vers une naturalisation, vers un impensé de sa construction sociale et culturelle. Mais l’énergie n’est pas naturelle ! Tout au moins, elle n’est pas que naturelle. La naturalisation dont elle fait l’objet sera d’autant plus aisée que l’énergie sera culturellement vécue comme une abstraction.
Par exemple, la présence de la « fée électricité », censée se substituer aux énergies jugées sales comme le charbon ou le gaz de ville à la fin du XXe siècle, a fini par devenir discrète, abstraite (Beltran, 1995). L’adoption de l’électricité comme source commune voire universelle d’énergie renforce cette tendance à la naturalisation qui devient, par retour, le signe d’une appropriation réussie de cette énergie par ceux qui en font usage, c’est-à-dire nous tous. Cette naturalisation de l’énergie fossile s’inscrit dans le cadre d’un « macro système technique » en oeuvre. Gras et Poirot-Delpech (1993) en énumèrent les éléments constitutifs, qu’ils soient matériels ou idéels : récupération de l’énergie emprisonnée, accumulation, délocalisation et indépendance de la production et de sa consommation, abstraction de la puissance énergétique, redistribution à volonté en des lieux éloignés de la source, création de centres gestionnaires et de canaux de transport. Ce type de système nécessite pour fonctionner une cohorte d’ingénieurs de spécialistes et d’experts pour produire et distribuer l’énergie. Pour l’usager moyen que nous sommes, l’origine de l’énergie qui met en mouvement les machines de son quotidien reste une énigme. Nous ne voyons que la machine qui nous obéit. Nous ne pensons guère à ce macro système collectif technique qui nous permet pourtant de disposer à volonté de cette énergie dès que nous actionnons un interrupteur ou faisons démarrer le moteur de notre automobile. Pourtant le monde n’est que fils électriques, rails, couloirs aériens, ports, aéroports, mines de charbon, centrales électriques, et nous ne cessons de manipuler boutons, manettes, robots de toutes sortes, comme si tout partait de chacun de nous.
La crise énergétique et environnementale, facteur de dénaturalisation Cette vision naturaliste de l’énergie faiblit une première fois dans les années 70, quand les robinets sont fermés par l’OPEP. La dépendance à l’énergie se fait brutalement ressentir. Dans les sociétés occidentales, les répercussions sont considérables, les citoyens font la queue pour obtenir du carburant. La forte croissance économique enregistrée dans les années 60 semble stoppée, pour longtemps. Des craintes se font jour à propos de la raréfaction, voire de l’épuisement des ressources. Mais le contre-choc pétrolier effacera ces soucis au cours des années 80. Les tenants des ressources inépuisables, un temps mis en cause, reprennent la main. La « crise environnementale » constitue un second choc, moins spectaculaire mais plus profond. Nous le subissons toujours. L’émergence du risque des changements climatiques focalise les débats sur l’énergie. La prise de conscience s’étend sur plusieurs décennies, du Sommet de Stockholm (1972) à celui de Rio (1992) puis de Kyoto (1997). Elle s’approfondit. Au coeur des accusations, les gaz à effet de serre émis par les combustibles fossiles. À la différence de la crise pétrolière des années 70, nous nous persuadons rapidement qu’il n’existe aucun moyen simple, ni technique, ni politique, pour réduire les émissions de CO2. De plus, alors que les pays industrialisés peinent à se conformer aux engagements qu’ils ont pris au titre du Protocole de Kyoto, les « pays émergents » demandent leur part du gâteau et n’entendent pas limiter leurs émissions. Impossible de les y contraindre. Or les nouvelles sont chaque jour plus pessimistes. Sir Nicholas Stern (2006) auteur de la première étude fixant un prix officiel sur les dégâts possibles des changements climatiques, affirme aujourd’hui qu’il a peut-être sous-estimé le problème. À ceci s’ajoute la flambée récente du baril de pétrole qui vient accréditer la thèse d’un proche épuisement des ressources. Une association de géologues retraités des grandes compagnies, l’ASPO (Association for the Study of the Peak Oil) finissent par insinuer un doute sur la véracité du scénario de référence de l’Agence Internationale de l’Energie, qui prévoyait en 2004 un prix du baril de pétrole constant à 30 dollars jusqu’en 2030. Bien sûr, d’autres raisons peuvent expliquer la flambée : ouragans, manque de capacités de raffinage du fait d’une excessive spéculation financière dans les années 90 etc. Toutefois, la question des limites ressurgit. Miser sur les biocarburants pour remplacer les fossiles ? L’idée n’aura pas tenu un an.
Les autres énergies renouvelables ? Elles ne représentent qu’une fraction de l’approvisionnement et demanderont des décennies avant d’être déployées à grande échelle – ce qui n’ira pas sans heurts avec les habitants, le sol étant toujours, à la différence du sous-sol, sujet à des conflits d’usage. Le nucléaire ? Les risques qui l’accompagnent, les incidents, le prix, la lenteur et la complexité de mise en oeuvre sont telles que ses partisans reconnaissent qu’il ne pourra au mieux être qu’une partie de la solution.
Les enjeux d’une circulation différente Avec la crise du naturalisme, ce qui était invisible, car trop évident, devient visible, car problématique. Les ingénieurs et les techniciens sont pris à partie. Le grand public découvre peu à peu sa dépendance massive envers les énergies fossiles et leurs réseaux. L’économie s’intéresse aux « externalités négatives » qui, contre toute attente, ne sont pas ou mal endiguées par les mesures prises. Les activités modernes sont redécouvertes et réinterprétées. Nous nous éloignons de l’idée des lendemains qui chantent, un avenir dans lequel les énergies domestiquées permettraient à l’être humain de jouir d’un monde bien administré. La science est contestée, il est question de « démocratie technique » – un oxymore ? La thématique de « l’environnement », celle de « l’épuisement des ressources » ouvrent à nouveau la question de la circulation de l’énergie.
La notion d’environnement, qui jusque-là désignait le pourtour d’un lieu, un ensemble d’éléments situés dans un rayon donné, à portée des sens, est mobilisée, tout d’abord en langue anglaise, pour désigner le champ d’une crise. Le progrès technique devient hésitant : armes destructrices, changements climatiques, catastrophes technologiques, inégalités persistantes. La circulation de l’énergie, que les sociétés développées pensaient avoir domestiqué grâce à la division du travail et l’organisation des échanges marchands ne répond plus aux exigences de notre milieu de vie. Comme l’ont montré Lepage et Guéry (2000), la notion « d’environnement » finit par désigner le « milieu » comme sans attache avec l’idée de progrès. Au contraire, il devient lieu d’incertitude. On ne sait pas quand, dans quelles proportions et avec quelle brutalité le climat changera, le pétrole se raréfiera, les écosystèmes s’effondreront – ou pas. Dès lors l’angoisse et surtout la peur remplacent la confiance dans l’évolution des systèmes techniques. De cette situation émerge donc peu à peu l’idée que la place de l’énergie doit être repensée. Tout un champ de recherche se structure : l’écologie industrielle, le métabolisme territorial, les analyses de cycle de vie etc. Les activités économiques se découvrent sous un jour totalement nouveau. Des systèmes d’information, des « systèmes de management de l’environnement » se mettent en place. L’écologie devient le concept cardinal de cette nouvelle rationalité. À la question de la relation entre matière, énergie et valeur économique, se substitue celle de la relation entre valeur économique, égalité sociale et cycles écologiques. Le terme de « développement durable » voit le jour. Les sciences humaines commencent à s’intéresser à cette question de l’énergie. La sociologie crée de nouveaux enseignements consacrés à l’environnement et aux risques. L’ethnologie et l’anthropologie changent de regard sur les sociétés « sous-développées », et s’intéressent à leur capacité supposée à avoir vécu très longtemps « en harmonie avec la nature ». On cherche ainsi à mieux informer le consommateur, pour qu’il puisse se rendre compte du contenu énergétique des objets qu’il utilise.
Rationalité économique et évacuation du collectif Le contexte de crise du début des années 2000 induit des réflexions axées sur les manières d’économiser l’énergie. Les organisations internationales comme les Etats s’adressent aux utilisateurs finaux. En matière de maîtrise de l’énergie, les approches individualistes prédominent. Elles font souvent l’économie des contextes sociaux, culturels, de l’appartenance des « consommateurs » à des ensembles collectifs et à des réseaux d’interactions. La crise énergétique favorise l’élaboration de « politiques publiques » axées sur l’information et la responsabilisation de consommateurs rationnels et plutôt individualistes. Cela revient à dissocier l’énergie prise comme mode de consommation, des configurations socio-techniques et culturelles qui encadrent cette consommation. La consommation d’énergie est plutôt posée dans le seul domaine de la sphère individuelle. Elle est l’objet de la responsabilité individuelle des consommateurs que nous sommes. Nous pouvons nous interroger sur la pertinence de ces politiques au regard de l’échec des incitations à économiser l’énergie. Si la consommation ou l’économie d’énergie est renvoyée à la sphère individuelle des comportements de consommation, cette dernière constitue un « trou noir » de la réflexion portant sur la relation homme – énergie (Dujin et al. 2007). À contrario, peu de réflexions émergent à propos du rôle des macro systèmes techniques dans le gaspillage ou la maîtrise collective de l’énergie. Ces macro- systèmes techniques constituent la norme en matière de production et de consommation énergétiques dans les pays occidentaux. La sortie éventuelle de ces systèmes, qui constituent le cadre dans lequel nous continuons à envisager des solutions pour résoudre la crise énergétique parait inenvisageable, soit comme une voie alternative pas toujours crédible. Elle contrarie les opérateurs, qui perdent des clients, mais aussi les autorités publiques, qui y voient une contraction de leur champ d’action. Elle remet en cause la conception traditionnelle du progrès, basée sur l’allongement des circuits de production, consécutive à l’accroissement de la division du travail et aux gains de productivité afférents. Pourtant un nombre grandissant d’acteurs associatifs s’y intéresse, car cela ouvre la voie à l’utilisation de techniques très économes et « écologiques » – bâtiments basse consommation, relocalisation des circuits agricoles etc. Poser les problèmes en termes techniques ou comportementaux, comme c’est le plus souvent le cas, ne permet pas d’ouvrir un débat proprement politique sur les normes de vie en commun. Sans cela, comment savoir si les solutions proposées sont bien à la hauteur des enjeux tels que les citoyens les perçoivent ? À n’ouvrir le sujet que dans d’étroites limites, on engendre frustrations et oppositions, les personnes étant finalement conduites à détourner les réponses proposées qui, de leur point de vue, ne sont pas adaptées. Une meilleure prise en compte des dimensions sociales et culturelles permet à coup sûr de renouveler la manière d’aborder ces questions et de mieux intégrer le rôle joué par les actions individuelles.
Introduction
par Menozzi M.-J., Flipo F., Pécaud D.
La question de l’énergie, au sens de sa disponibilité, sa raréfaction éventuelle et sa consommation semble installée pour longtemps sur le devant de la scène. Le renouvellement de l’énergie, les modalités de sa production et de sa consommation soulèvent de multiples interrogations qui rejoignent des préoccupations plus générales ayant trait au phénomène du réchauffement climatique, à la disponibilité en ressources fossiles et à l’orientation de l’activité humaine vers un développement durable. Notre manière de vivre dans les sociétés occidentales, organisée autour de l’abondance énergétique issue de l’exploitation des ressources fossiles est remise en cause. Depuis les révolutions industrielles du dix-neuvième siècle, et de manière accrue depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le mode de vie des sociétés occidentales impose une consommation énergétique importante. Cette « dépendance » énergétique n’est pas sans effet sur l’organisation sociale, mais, réciproquement, celle-ci influence les formes de production et de consommation énergétiques. Par exemple, certaines de ces modalités d’organisation seraient probablement différentes si le courant continu à basse tension avait été préféré au courant alternatif de haute tension. En effet, ce dernier, non stockable, favorise une production centralisée et l’existence d’un réseau unifié pour faciliter sa diffusion, alors que le courant continu à basse tension, stockable s’accommode mieux d’une production délocalisée dans de petites unités spécialisées. Le choix technique en faveur du courant alternatif fut aussi un choix d’organisation sociale (Gras et Poirot-Delpech, 1993). Nous pouvons également remarquer qu’à un niveau microsocial, la gestion et l’utilisation de l’électricité structure et est structurée par l’organisation de la cellule familiale (Desjeux et al., 1996), ou bien encore que l’organisation de l’espace social, la distance entre nos lieux de vie et de travail sont pour partie conditionnées par la disponibilité d’une énergie peu onéreuse. Les sciences humaines et sociales ne se préoccupent guère de l’objet « énergie » comme d’un élément constitutif de faits sociaux. Wilhite (2001 ; 2005) n’hésite pourtant pas à affirmer que l’énergie a besoin de l’anthropologie alors que, le plus souvent, les débats sur l’énergie restent cantonnés à des préoccupations « techniques » ou économiques. De plus, malgré la répétition des déclarations des responsables politiques à ce sujet, les politiques publiques incitant à la maîtrise de l’énergie restent rares, et la consommation nette par habitant stable ou en augmentation.
Les aspects disciplinaires La définition actuelle de l’énergie est l’héritage du développement de la société industrielle au XIXe siècle, plus précisément d’une société « thermo-industrielle » (Gras, 2002) s’appuyant, grâce à la maîtrise « du feu » sur l’usage d’une énergie produite par la vapeur issue de la combustion d’énergies fossiles comme le charbon, puis, plus tard, le pétrole, le gaz ou l’uranium. L’usage de ces énergies est concomitant de l’émergence de modes de vie, de production et de consommation organisés à partir de méga-machines qui modifient en même temps nos représentations de l’espace, du temps. C’est donc, de manière plus générale la relation homme-nature qui se trouve ainsi bouleversée. Jusque là, l’énergie utilisée provenait le plus souvent de sources renouvelables, telles la biomasse animale, l’énergie humaine, le vent ou l’eau. L’utilisation de l’énergie fossile entraîne une nouvelle manière de « gérer » l’énergie, en la distribuant et en la stockant pour différer son usage. L’énergie devient, non plus une chose à réguler la plupart du temps de manière collective, mais plus une chose qu’il s’agit d’emprisonner, de s’approprier en grandes quantités pour ensuite la redistribuer. Elle alimente un imaginaire nouveau portant sur la légitimité d’une prédation généralisée de la nature. De plus, la consommation énergétique constitue une manifestation du « progrès ». Par exemple, Gras et al. (1993) affirment que le projet d’exploiter des stocks de charbon ne pouvait provenir de sociétés fondées sur un rapport avec la nature d’équilibre et de prise en compte de renouvellement des ressources. L’énergie telle qu’elle est pensée par la société et la science occidentale du XIXe siècle n’induit pourtant pas que les sociétés non occidentales ou les sociétés historiquement antérieures ne se représentaient pas l’énergie. Toutes concevaient le monde comme un échange incessant de transformations. L’énergie comme ressource et comme usage reste le plus souvent présentée comme une condition technique de l’organisation des groupements humains et non pas comme l’un des éléments de cette organisation et de sa stabilité. Depuis l’avènement de la thermodynamique, s’est imposée l’image d’une énergie comprise comme une réalité purement physique pouvant être maîtrisée grâce à des procédés techniques teintés d’une rationalité réputée « naturelle » et universelle : le calcul économique.
L’énergie devient alors un facteur de production parmi d’autres, et pas le plus important, puisque son coût, dans la comptabilité des entreprises et des nations, est allé en diminuant au fur et à mesure du développement industriel. Seules quelques « crises énergétiques » secouent épisodiquement cette vision des choses, mais, le marché étant réputé révéler la valeur que les acteurs attribuent aux choses, l’énergie, jusqu’à des temps récents, a progressivement perdu sa valeur au fur et à mesure que son prix baissait.
Le primat de la lecture économique des sociétés humaines a conduit à une tendance à dépeindre un développement universel caractérisé par une succession de « phases » déclenchées les unes après les autres par des événements particuliers. Les sociétés auraient donc connu une vie agricole pendant des millénaires, puis elles auraient découvert une rationalité particulière leur permettant de développer leur industrie, puis elles se seraient tertiarisées, le secteur économique dit « primaire », dont fait partie le secteur de « l’énergie », étant peu à peu réduit à la portion congrue. Enfin, les machines grossières vont faire un usage de plus en plus fin et précis de l’énergie (Simondon, 2001), ce mouvement culminant dans les technologies de l’information et de la communication. Cette vision économique des sociétés humaines a joué un rôle prépondérant, reléguant le plus souvent d’autres approches anthropologiques et ethnologiques, à la marge de la réflexion. De plus, celles-là se sont souvent appuyées sur cette vision dominante, la tenant pour un résultat acquis de la recherche. Debeir et al. (1986) constatent qu’une telle approche conduit à l’étude de plus en plus spécialisée des procédés techniques et du rapport machines – capitaux, de l’organisation du travail mais aussi des réseaux d’échange comme éléments dominants de la réflexion sur l’énergie.
Cette tendance est visible dans les pays occidentaux aussi bien que dans les pays dits en développement. Baudy et al. (1995) soulignent le manque de prise en compte des facteurs sociaux et culturels dans l’élaboration de stratégies ou de politiques énergétiques. Pourtant l’énergie reste un fait social. Les conditions techniques de sa production et de son utilisation sont étroitement enchâssées dans l’organisation de toute action collective, à la fois à travers les pratiques et les systèmes de représentations. La réflexion sur l’énergie fossile et sur son usage dans la société industrielle peut développer un regard critique à propos du rapport que nous entretenons avec la nature, à propos des rapports sociaux agressifs ou déséquilibrés que cet usage impose, à propos d’une légitimation implicite d’une dégradation de la nature qu’il induit. La manière dominante d’envisager la question de l’énergie illustre le cloisonnement des approches disciplinaires, à partir d’une opposition définie a priori entre « nature » compris comme ce qui constitue l’universalité des déterminations matérielles et « culture », qui renvoie à la diversité des manifestations individuelles et collectives et à leur dimension subjective et institutionnelle. Aux ingénieurs et aux économistes revient l’étude de ce qui relève de la nature et de la maîtrise des éléments matériels, organisés autour de réseaux appréhendés à travers leur dimension technique. Pendant ce temps, on peut observer du côté des sciences sociales une propension à évacuer les questions relevant des techniques et la dimension matérielle de l’analyse des mondes sociaux. Ainsi la question énergétique est-elle finalement renvoyée à un ordre naturel. L’énergie reste donc « la chose » des économistes et des ingénieurs, les sciences humaines ne s’y intéressant qu’épisodiquement, et le plus souvent pour s’en émerveiller – le triomphe de l’homme sur la nature – ou s’en affliger – la soumission des êtres humains à une méga-machine dont la logique deviendrait de plus en plus étrangère à l’exercice de leur subjectivité.
Naturalisation d’une circulation particulière de l’énergie Pour cet ouvrage, nous avons souhaité mettre au même rang des éléments qui composent les sociétés et leur histoire, l’énergie et ses usages. Nous pensons que l’énergie constitue à part entière la forme des sociétés alors que les points de vue dominants l’entraînent vers une naturalisation, vers un impensé de sa construction sociale et culturelle. Mais l’énergie n’est pas naturelle ! Tout au moins, elle n’est pas que naturelle. La naturalisation dont elle fait l’objet sera d’autant plus aisée que l’énergie sera culturellement vécue comme une abstraction.
Par exemple, la présence de la « fée électricité », censée se substituer aux énergies jugées sales comme le charbon ou le gaz de ville à la fin du XXe siècle, a fini par devenir discrète, abstraite (Beltran, 1995). L’adoption de l’électricité comme source commune voire universelle d’énergie renforce cette tendance à la naturalisation qui devient, par retour, le signe d’une appropriation réussie de cette énergie par ceux qui en font usage, c’est-à-dire nous tous. Cette naturalisation de l’énergie fossile s’inscrit dans le cadre d’un « macro système technique » en oeuvre. Gras et Poirot-Delpech (1993) en énumèrent les éléments constitutifs, qu’ils soient matériels ou idéels : récupération de l’énergie emprisonnée, accumulation, délocalisation et indépendance de la production et de sa consommation, abstraction de la puissance énergétique, redistribution à volonté en des lieux éloignés de la source, création de centres gestionnaires et de canaux de transport. Ce type de système nécessite pour fonctionner une cohorte d’ingénieurs de spécialistes et d’experts pour produire et distribuer l’énergie. Pour l’usager moyen que nous sommes, l’origine de l’énergie qui met en mouvement les machines de son quotidien reste une énigme. Nous ne voyons que la machine qui nous obéit. Nous ne pensons guère à ce macro système collectif technique qui nous permet pourtant de disposer à volonté de cette énergie dès que nous actionnons un interrupteur ou faisons démarrer le moteur de notre automobile. Pourtant le monde n’est que fils électriques, rails, couloirs aériens, ports, aéroports, mines de charbon, centrales électriques, et nous ne cessons de manipuler boutons, manettes, robots de toutes sortes, comme si tout partait de chacun de nous.
La crise énergétique et environnementale, facteur de dénaturalisation Cette vision naturaliste de l’énergie faiblit une première fois dans les années 70, quand les robinets sont fermés par l’OPEP. La dépendance à l’énergie se fait brutalement ressentir. Dans les sociétés occidentales, les répercussions sont considérables, les citoyens font la queue pour obtenir du carburant. La forte croissance économique enregistrée dans les années 60 semble stoppée, pour longtemps. Des craintes se font jour à propos de la raréfaction, voire de l’épuisement des ressources. Mais le contre-choc pétrolier effacera ces soucis au cours des années 80. Les tenants des ressources inépuisables, un temps mis en cause, reprennent la main. La « crise environnementale » constitue un second choc, moins spectaculaire mais plus profond. Nous le subissons toujours. L’émergence du risque des changements climatiques focalise les débats sur l’énergie. La prise de conscience s’étend sur plusieurs décennies, du Sommet de Stockholm (1972) à celui de Rio (1992) puis de Kyoto (1997). Elle s’approfondit. Au coeur des accusations, les gaz à effet de serre émis par les combustibles fossiles. À la différence de la crise pétrolière des années 70, nous nous persuadons rapidement qu’il n’existe aucun moyen simple, ni technique, ni politique, pour réduire les émissions de CO2. De plus, alors que les pays industrialisés peinent à se conformer aux engagements qu’ils ont pris au titre du Protocole de Kyoto, les « pays émergents » demandent leur part du gâteau et n’entendent pas limiter leurs émissions. Impossible de les y contraindre. Or les nouvelles sont chaque jour plus pessimistes. Sir Nicholas Stern (2006) auteur de la première étude fixant un prix officiel sur les dégâts possibles des changements climatiques, affirme aujourd’hui qu’il a peut-être sous-estimé le problème. À ceci s’ajoute la flambée récente du baril de pétrole qui vient accréditer la thèse d’un proche épuisement des ressources. Une association de géologues retraités des grandes compagnies, l’ASPO (Association for the Study of the Peak Oil) finissent par insinuer un doute sur la véracité du scénario de référence de l’Agence Internationale de l’Energie, qui prévoyait en 2004 un prix du baril de pétrole constant à 30 dollars jusqu’en 2030. Bien sûr, d’autres raisons peuvent expliquer la flambée : ouragans, manque de capacités de raffinage du fait d’une excessive spéculation financière dans les années 90 etc. Toutefois, la question des limites ressurgit. Miser sur les biocarburants pour remplacer les fossiles ? L’idée n’aura pas tenu un an.
Les autres énergies renouvelables ? Elles ne représentent qu’une fraction de l’approvisionnement et demanderont des décennies avant d’être déployées à grande échelle – ce qui n’ira pas sans heurts avec les habitants, le sol étant toujours, à la différence du sous-sol, sujet à des conflits d’usage. Le nucléaire ? Les risques qui l’accompagnent, les incidents, le prix, la lenteur et la complexité de mise en oeuvre sont telles que ses partisans reconnaissent qu’il ne pourra au mieux être qu’une partie de la solution.
Les enjeux d’une circulation différente Avec la crise du naturalisme, ce qui était invisible, car trop évident, devient visible, car problématique. Les ingénieurs et les techniciens sont pris à partie. Le grand public découvre peu à peu sa dépendance massive envers les énergies fossiles et leurs réseaux. L’économie s’intéresse aux « externalités négatives » qui, contre toute attente, ne sont pas ou mal endiguées par les mesures prises. Les activités modernes sont redécouvertes et réinterprétées. Nous nous éloignons de l’idée des lendemains qui chantent, un avenir dans lequel les énergies domestiquées permettraient à l’être humain de jouir d’un monde bien administré. La science est contestée, il est question de « démocratie technique » – un oxymore ? La thématique de « l’environnement », celle de « l’épuisement des ressources » ouvrent à nouveau la question de la circulation de l’énergie.
La notion d’environnement, qui jusque-là désignait le pourtour d’un lieu, un ensemble d’éléments situés dans un rayon donné, à portée des sens, est mobilisée, tout d’abord en langue anglaise, pour désigner le champ d’une crise. Le progrès technique devient hésitant : armes destructrices, changements climatiques, catastrophes technologiques, inégalités persistantes. La circulation de l’énergie, que les sociétés développées pensaient avoir domestiqué grâce à la division du travail et l’organisation des échanges marchands ne répond plus aux exigences de notre milieu de vie. Comme l’ont montré Lepage et Guéry (2000), la notion « d’environnement » finit par désigner le « milieu » comme sans attache avec l’idée de progrès. Au contraire, il devient lieu d’incertitude. On ne sait pas quand, dans quelles proportions et avec quelle brutalité le climat changera, le pétrole se raréfiera, les écosystèmes s’effondreront – ou pas. Dès lors l’angoisse et surtout la peur remplacent la confiance dans l’évolution des systèmes techniques. De cette situation émerge donc peu à peu l’idée que la place de l’énergie doit être repensée. Tout un champ de recherche se structure : l’écologie industrielle, le métabolisme territorial, les analyses de cycle de vie etc. Les activités économiques se découvrent sous un jour totalement nouveau. Des systèmes d’information, des « systèmes de management de l’environnement » se mettent en place. L’écologie devient le concept cardinal de cette nouvelle rationalité. À la question de la relation entre matière, énergie et valeur économique, se substitue celle de la relation entre valeur économique, égalité sociale et cycles écologiques. Le terme de « développement durable » voit le jour. Les sciences humaines commencent à s’intéresser à cette question de l’énergie. La sociologie crée de nouveaux enseignements consacrés à l’environnement et aux risques. L’ethnologie et l’anthropologie changent de regard sur les sociétés « sous-développées », et s’intéressent à leur capacité supposée à avoir vécu très longtemps « en harmonie avec la nature ». On cherche ainsi à mieux informer le consommateur, pour qu’il puisse se rendre compte du contenu énergétique des objets qu’il utilise.
Rationalité économique et évacuation du collectif Le contexte de crise du début des années 2000 induit des réflexions axées sur les manières d’économiser l’énergie. Les organisations internationales comme les Etats s’adressent aux utilisateurs finaux. En matière de maîtrise de l’énergie, les approches individualistes prédominent. Elles font souvent l’économie des contextes sociaux, culturels, de l’appartenance des « consommateurs » à des ensembles collectifs et à des réseaux d’interactions. La crise énergétique favorise l’élaboration de « politiques publiques » axées sur l’information et la responsabilisation de consommateurs rationnels et plutôt individualistes. Cela revient à dissocier l’énergie prise comme mode de consommation, des configurations socio-techniques et culturelles qui encadrent cette consommation. La consommation d’énergie est plutôt posée dans le seul domaine de la sphère individuelle. Elle est l’objet de la responsabilité individuelle des consommateurs que nous sommes. Nous pouvons nous interroger sur la pertinence de ces politiques au regard de l’échec des incitations à économiser l’énergie. Si la consommation ou l’économie d’énergie est renvoyée à la sphère individuelle des comportements de consommation, cette dernière constitue un « trou noir » de la réflexion portant sur la relation homme – énergie (Dujin et al. 2007). À contrario, peu de réflexions émergent à propos du rôle des macro systèmes techniques dans le gaspillage ou la maîtrise collective de l’énergie. Ces macro- systèmes techniques constituent la norme en matière de production et de consommation énergétiques dans les pays occidentaux. La sortie éventuelle de ces systèmes, qui constituent le cadre dans lequel nous continuons à envisager des solutions pour résoudre la crise énergétique parait inenvisageable, soit comme une voie alternative pas toujours crédible. Elle contrarie les opérateurs, qui perdent des clients, mais aussi les autorités publiques, qui y voient une contraction de leur champ d’action. Elle remet en cause la conception traditionnelle du progrès, basée sur l’allongement des circuits de production, consécutive à l’accroissement de la division du travail et aux gains de productivité afférents. Pourtant un nombre grandissant d’acteurs associatifs s’y intéresse, car cela ouvre la voie à l’utilisation de techniques très économes et « écologiques » – bâtiments basse consommation, relocalisation des circuits agricoles etc. Poser les problèmes en termes techniques ou comportementaux, comme c’est le plus souvent le cas, ne permet pas d’ouvrir un débat proprement politique sur les normes de vie en commun. Sans cela, comment savoir si les solutions proposées sont bien à la hauteur des enjeux tels que les citoyens les perçoivent ? À n’ouvrir le sujet que dans d’étroites limites, on engendre frustrations et oppositions, les personnes étant finalement conduites à détourner les réponses proposées qui, de leur point de vue, ne sont pas adaptées. Une meilleure prise en compte des dimensions sociales et culturelles permet à coup sûr de renouveler la manière d’aborder ces questions et de mieux intégrer le rôle joué par les actions individuelles.